Paru en 2015, le livre de Susan Golombock, chercheuse spécialisée sur la famille et ses évolutions, compile les milliers d’études consacrées aux nouvelles formes de parentalité. Et conclut que du point de vue de l’enfant, ce qui compte pour bien grandir, c’est la qualité des interactions avec les membres de sa famille bien plus que la composition même de cette famille.
C’était il y a deux ans et demi . Des manifestations, des défilés, des pancartes « un papa et une maman », et une sacrée pagaille chez les psys. Le 23 avril 2013 le mariage pour tous était finalement voté. La crainte de voir disparaître la famille traditionnelle avait nourri l’essentiel des débats. En accordant le mariage aux couples homosexuels, on leur ouvrait le droit à l’adoption, le début de la fin. Certains éminents psychanalystes (dont Jean-Pierre Winter, Pierre Levy-Soussan, Christian Flavigny) ont prédit le pire pour les enfants élevés par des couples homosexuels. D’autres (Laurence Croix et Olivier Douville), furieux que Freud soit récupéré à des fins idéologiques, ont lancé une pétition qui a recueilli 1200 signatures, affirmant que rien dans le corpus psychanalytique ne venait justifier une condamnation de l’homoparentalité.
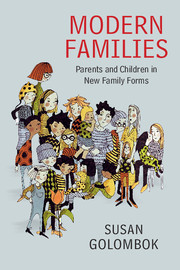 Au cœur de ce débat, les études sur le devenir des enfants. Depuis 40 ans, elles se comptent par centaines. Dans un livre qui vient de paraître en Grande-Bretagne, Modern Families, Susan Golombok, chercheuse anglaise spécialiste de la famille qui travaille sur le sujet depuis les années 70, recense la plupart d’entre elles, les résume, les recoupe, les met en perspective, les compare, dans le but de parler de ces « familles modernes » : les homoparents, mais aussi les mères solo, les enfants issus de l’AMP, de dons de gamète, de mère porteuse. En France on a l’habitude de balayer ces données d’un revers de la main, les accusant de mille et un biais méthodologiques. C’est vrai que débattre in abstracto, à grands coups de théories, ça a quand même plus de panache.
Au cœur de ce débat, les études sur le devenir des enfants. Depuis 40 ans, elles se comptent par centaines. Dans un livre qui vient de paraître en Grande-Bretagne, Modern Families, Susan Golombok, chercheuse anglaise spécialiste de la famille qui travaille sur le sujet depuis les années 70, recense la plupart d’entre elles, les résume, les recoupe, les met en perspective, les compare, dans le but de parler de ces « familles modernes » : les homoparents, mais aussi les mères solo, les enfants issus de l’AMP, de dons de gamète, de mère porteuse. En France on a l’habitude de balayer ces données d’un revers de la main, les accusant de mille et un biais méthodologiques. C’est vrai que débattre in abstracto, à grands coups de théories, ça a quand même plus de panache.
Voici en tous cas ce qu’expose Susan Golombok, experte parmi les experts, dans ce livre pour le moment uniquement disponible en anglais.
Au départ : ces mères lesbiennes privées de leurs enfants
Les premières études sur les familles homoparentales sont nées aux USA dans les années 70. Les mères lesbiennes perdaient quasi systématiquement la garde de leur enfant (né d’un mariage hétérosexuel) après leur divorce parce que les juges considéraient qu’il n’était pas dans son intérêt d’être élevé par une mère homosexuelle. « Les batailles au sujet de la garde se jouaient en dehors des tribunaux avec des témoins experts, ceux du côté des pères (en général des psychanalystes) arguant que grandir dans une famille lesbienne aurait des effets dévastateurs sur le bien-être psychologique des enfants, ceux du côté des mères (généralement un pédopsychiatre) expliquant que ce qui comptait le plus pour le bien-être psychologique d’un enfant c’était la qualité des relations familiales. En l’absence de données empiriques sur le devenir des enfants élevés par une famille lesbienne, les juges accordaient la garde au père qui souvent avait trouvé une nouvelle compagne avant que l’affaire n’arrive devant le tribunal, et qui pouvait donc offrir une famille traditionnelle à l’enfant, une situation qui était préférée à celle d’une mère de famille lesbienne. »
Trois principaux arguments ont été invoqués contre les mères lesbiennes : elles rempliraient moins bien leur rôle de « mère nourricière », ce qui aurait un impact négatif sur leurs enfants. La stigmatisation et le rejet subis par les enfants rejailliraient aussi sur leur équilibre, et, enfin, les enfants allaient souffrir de troubles de l’identité sexuelle, les garçons étant moins masculin et les filles moins féminines, avec la crainte ultime qu’ils ne deviennent eux-mêmes homosexuels.
Les théories psychologiques en cours à l’époque n’aboutissaient pas aux mêmes conclusions. Les plus alarmistes étaient les psychanalystes qui mettaient en avant la nécessité d’un couple parental hétérosexuel pour permettre à l’enfant la résolution du complexe oedipien, perçu comme central dans la construction de l’identité sexuelle. Les « théories de l’apprentissage social » pointaient elles aussi le rôle prééminent des parents dans la construction de l’identité sexuelle des enfants mais estimaient que les autres adultes pouvaient constituer des modèles référents. Les théoriciens du développement cognitif considéraient que le rôle des parents était moins important que l’influence de l’environnement extérieur.
La constante critique du biais méthodologique pour disqualifier les études
Pour y voir plus clair et pouvoir trancher enfin le débat, le premières études ont donc été lancées. Elles ont continué pendant 40 ans. Au fur et à mesure des années les cohortes se sont étoffées et diversifiées puisqu’il ne s’agissait plus seulement d’étudier les familles constituées d’une femme lesbienne ayant eu des enfants d’une première union hétérosexuelle mais des couples de femmes ayant recours à l’AMP pour avoir des enfants. Des centaines d’études ont été conduites, pour la plupart aux USA ou en Grande-Bretagne (mais pas que). Susan Golombok évoque évidemment les critiques et la suspicion dont ces études ont fait (et font toujours) l’objet : les échantillons seraient trop petits et pas assez représentatifs, les participants seraient tous des volontaires voire des militants soucieux de donner une image positive de ces familles et ne répondant pas honnêtement aux questionnaires, ce qui constituerait un biais méthodologique de taille.
L’auteure répond d’abord que la validité scientifique d’études sociologique ou psychologique a rarement été autant passée au crible. Pour résoudre le problème de la taille des échantillons, les chercheurs ont procédé à plusieurs méta-analyses qui toutes, aboutissent aux mêmes conclusions (exposées ci-dessous). Quant au problème de la représentativité des participants, Susan Golombok estime que cette critique ne tient pas. D’abord parce que le recrutement ne s’est pas seulement fait à travers les associations militantes ou sur la seule base du volontariat, ensuite parce que les études menées ont multiplié les modalités d’enquêtes (entretiens, test psychologiques sur les enfants, observations, questionnaires, interviews d’enseignants ou de pères). Elle l’assure : « l’incapacité à trouver des problèmes psychologiques plus importants chez les enfants de mères lesbiennes dans chacune des études menées ne peut pas simplement résulter d’un manque de consistance statistique. » Plus loin : « Ce qui est frappant avec ces investigations menées en différents lieux pendant 40 ans, étant donnée la diversité des méthodes employées, c’est la cohérence des résultats. »
Quels sont-ils ? Pas une seule étude n’a pu conclure que les enfants élevés par des mères homosexuelles (nés d’un mariage hétérosexuel ou issus d’un don de sperme) sont plus à risque de rencontrer des problèmes émotionnels ou des troubles du comportement que leurs pairs élevés par des couples hétérosexuels. Ces enfants fonctionnent normalement, ne manifestent pas de troubles de l’identité sexuelle et ne deviennent pas plus que les autres homosexuels à l’âge adulte.
Les bébés conçus… dans des tubes
En 1969, lorsque Bob Edwards et Parick Steptoe publient leur premier article sur la FIV, ils ont été violemment attaqués par l’Eglise et les médias. Il faudra attendre 32 années après la naissance de Louise Brown, le premier bébé éprouvette, pour que Bob Edwards se voit remettre le prix Nobel.
Les hypothèses des premières études portant sur les enfants nés par FIV étaient que le stress dû à l’infertilité et l’arrivée d’un bébé très attendu auraient un impact sur les parents, lesquels risquaient de se montrer trop protecteurs ou d’avoir des attentes irréalistes vis à vis d’un bébé trop idéalisé. Les conclusions montrent qu’il n’en est rien. Il semble que les mères aient moins confiance en elles dans les premiers mois mais ces différences s’estompent rapidement. A l’adolescence il ne subsiste aucune différence. Les parents ayant eu recours à la FIV apparaissent comme très impliqués et ont de bonnes relations avec leurs enfants. Du côté de ces derniers (et malgré les très fortes craintes exprimées au début de la technique), mêmes résultats rassurants. Ces enfants ont peu de problèmes émotionnels, psychologiques ou de comportements et pas de troubles cognitifs.
Susan Golombok passe en revue les études menées sur les enfants issus d’une FIV-ICSI (lorsque le spermatozoïde est directement introduit dans l’ovocyte). C’est en effet à ce sujet que les inquiétudes les plus vives, et certainement les plus fondées scientifiquement, ont émergé. La manipulation du sperme puis de l’oeuf pouvait amener à craindre des répercussions sur le développement des enfants, notamment cognitif. Quelques rares études ont en effet conclu à un risque de QI moins élevé chez les enfants issus d’une FIV-ICSI. Il semblerait qu’un biais social ait joué, les pères de milieux socio-économiques faibles étant surreprésentés dans l’échantillon. L’auteure estime que la méta-analyse de ces études ne permet pas de conclure à une incidence de l’ICSI sur le développement des enfants.
Les enfants issus d’un don
Lorsque les premières études sur les enfants issus d’un don ont commencé, un parallèle a été effectué avec l’adoption : dans les deux cas il y avait une absence de lien biologique avec au moins l’un des deux parents et la question du secret allait se poser. Les très nombreuses études sur l’adoption ont montré un taux plus élevé de problèmes émotionnels ou comportementaux chez les enfants. Qu’en serait-il pour les enfants issus d’un don ?
On note depuis quelques années une plus forte proportion de parents ayant eu recours à un donneur désireux de dire la vérité à l’enfant. Mais dans les faits, les parents qui franchissent le pas sont encore une minorité. Et c’est vrai quelle que soit la législation du pays (anonymat total ou possibilité d’accès aux origines). Des études longitudinales ont analysé les familles où les parents avaient informé les enfants de leur conception et d’autres où le secret n’avait pas été levé. Dans les deux cas, les relations familiales sont bonnes, les parents investis, attentionnés et aimants, les enfants ne manifestent pas de troubles particuliers. Seule différence notable : dans les familles où l’enfant connaît l’origine de sa conception, il éprouve quelques difficultés à l’âge de 7 ans. L’auteure note à juste titre que les études longitudinales qui suivent les familles sur la durée n’ont pas encore de résultat concernant l’adolescence de ces enfants. Or, cette période constitue une étape plus complexe dans la formation de l’identité.
La transparence et l’accès aux origines
Les recherches sur les enfants adoptés ont montré que c’est à l’adolescence qu’ils manifestent le besoin d’accéder à leurs origines afin de construire leur identité. Ceux qui ont obtenu des informations disent que cela leur a permis d’aller mieux. « Il existe de plus en plus de preuves qu’un processus similaire se met en place pour les enfants issus d’un don de gamète, observe Susan Golombok (…). La transparence croissante s’est accompagnée d’un intérêt tout aussi croissant pour la recherche du donneur ». Susan Golombok le reconnaît : la proportion d’enfants issus de don qui cherchent leur donneur n’est pas connue. L’impossibilité d’accéder à cette statistique (déjà faudrait-il connaître le nombre exact d’enfants sachant qu’ils sont issus d’un don) explique en partie qu’en France la levée de l’anonymat constitue un débat jamais tranché, une arlésienne de la bioéthique.Face aux jeunes adultes en quête de leurs origines, qui témoignent de leur souffrance dans des livres et dans les médias, d’autres (médecins, dirigeants de CECOS, associations militantes de parents) peuvent arguer qu’ils ne constituent qu’une minorité, certes très bruyante, mais une minorité quand même. En l’absence de chiffres comment les contredire ? Et comment faire le poids contre l’argument massue consistant à dire que la levée de l’anonymat entraînerait une chute drastique des dons (alors que la pénurie est déjà criante en France) ?
Pour conclure cette partie, Susan Golombok reconnaît que les enfants et jeunes adolescents qui ne sont pas au courant de leur conception semblent aller très bien. Elle estime néanmoins qu’il existe toujours un risque que le secret soit éventé tardivement, ce qui se révèle traumatisant. Elle rappelle aussi que les familles où le secret a été levé lorsque l’enfant était petit semblent fonctionner de façon plus positive. La recherche d’un bien-être optimal de l’enfant devrait donc, selon elle, conduire à lui dire la vérité lors de la petite enfance. Elle enchaîne ensuite sur le fait que certains de ces enfants pourraient ensuite vouloir trouver leur donneur mais que la plupart d’entre eux ne sont pas à la recherche d’un père à proprement parler.
De façon assez étonnante, Susan Golombok évoque très peu ce qui fait énormément débat chez nous, la souffrance des enfants n’ayant pas accès à leurs origines. Elle parle de la recherche du donneur comme si celle-ci ne posait pas de soucis. Peut-être parce que les nombreuses études qu’elle cite ont été menées dans des pays où l’anonymat a été levé ou dans des pays où un système parallèle, non officiel mais très efficace, s’est mis en place pour permettre aux enfants d’entrer en relation avec leur parent génétique. C’est le cas aux Etats-Unis où le « Registre des frères et sœurs par le don » créé en 2000 par la mère d’un garçon ainsi conçu a enregistré 44.000 personnes et permis 11.000 correspondances. Susan Golombok précise d’ailleurs que les personnes inscrites sont plus à la recherche de leurs demi frères et sœurs (parfois nombreux) que de leur géniteur.
Mère porteuse, gestatrice, génitrice et autres petits détails
Que disent les (encore rares) études sur les enfants issus d’une mère porteuse ? Ces enfants ne diffèreraient pas des enfants conçus à l’aide d’une autre technique d’AMP et leur développement serait similaire à celui des enfants de la population générale. Seule différence : ces enfants, comme les enfants adoptés ou ceux issus d’un don manifestent quelques difficultés à l’âge de sept ans. Difficultés qui s’estompent ensuite pour disparaître à 10 ans.
L’auteure précise que la question de la gestation ne semble pas faire l’objet d’une forte préoccupation pour ces enfants qui manifestent à 10 ans une certaine indifférence. Reste l’interrogation portant sur l’adolescence et le développement de ces enfants sur le long terme. Du côté des parents, les résultats sont positifs. « Les différences relevées entre ces familles et les autres indiquent un plus grand bien-être psychologique et une meilleure adaptation à la parentalité des pères et mères ayant eu recours à une mère porteuse. » Idem pour les relations parents-enfants. « Les mères et les pères des familles issues de la GPA montrent davantage de chaleur, un meilleur attachement à leur enfant, et une parentalité plus joyeuse que dans les familles ayant conçu naturellement ». Susan Golombok note que la relation préexistante à la mère porteuse semble avoir un impact : lorsque celle-ci est une parente ou une amie, la mère d’intention semble plus à l’aise dans la maternité.
Autre enseignement intéressant : les parents ayant recours à une mère porteuse sont plus enclins que les parents ayant recours à un donneur à dire la vérité à leur enfant. Mais, s’ils expliquent volontiers qu’une dame a eu la gentillesse de prêter son ventre, ils sont beaucoup moins diserts sur le fait que cette même dame, ou une autre, a en plus donné ses ovocytes et que rien, ni la gestation, ni les gènes, ne relie en fait l’enfant à sa mère. Ce qui montre bien que pour les parents d’intention (et peut-être pour les enfants), la question de l’origine génétique est plus complexe est potentiellement plus perturbante que celle de la gestation. Lorsque l’affaire Mennesson (ce couple de Français qui bataille pour obtenir la reconnaissance à l’état civil de ses jumelles nées d’une mère porteuse) a été médiatisée en France au début des années 2000, personne ne disait ou n’écrivait qu’il y avait eu, en plus de la mère porteuse, une donneuse d’ovocytes. Le téléfilm adapté de leur histoire, Interdits d’enfants, diffusé sur France 2 en janvier 2013 a passé sous silence cette information. Des deux côtés de l’Atlantique, la question de savoir si le bébé porté par une autre est génétiquement celui des deux parents d’intention demeure l’une des plus épineuses.
Susan Golombok aborde évidemment le sujet sous l’angle de la gestatrice. Au-delà du devenir des enfants, c’est en effet le vécu de la femme qui le porte qui suscite, notamment en France, les plus grandes craintes. D’après une étude longitudinale menée au Royaume-Uni, où la pratique est légale et strictement encadrée, qu’elles soient la mère biologique de l’enfant ou pas (précision importante), les gestatrices ne semblent pas plus à risque de développer des troubles psychologiques ou une dépression post-natale. Les trois quarts des mères porteuses de la cohorte ont conservé des contacts avec l’enfant, que leurs propres enfants considèrent comme un demi frère ou une demi sœur. L’étude montre que les enfants de la mère porteuse n’ont pas été affectés par le geste de leur mère. Mais il s’agit d’une seule étude, ce qui est faible pour tirer des conclusions générales. Et rien n’est dit sur les « usines à bébé » de l’Inde où les gestatrices sont parquées dans des maternités bas de gamme. Pour des Français la question serait celle-ci : si plusieurs études validées scientifiquement prouvaient, dans les pays où existe un cadre législatif et un contrôle des pratiques, le bon développement des enfants et l’absence de séquelle psychologique pour la gestatrice et sa famille, accepterait-on pour autant de légaliser la gestation pour autrui ? C’est peu probable. Le débat revêt chez nous une dimension éthique et philosophique portant notamment sur l’inaliénabilité du corps humain.
Mères seules par choix : leurs enfants vont bien
C’est peut-être la partie la plus polémique du livre, celle qui va le plus à l’encontre des idées reçues. Susan Golombok remarque en préambule que les femmes qui décident d’avoir un bébé seules ont toujours fait l’objet d’un rejet et d’une condamnation sans appel. Certainement parce que les très nombreuses études sur les mères se retrouvant seules après un divorce ou abandonnées par le père ont mis en exergue la grande fragilité économique et sociale de ces femmes, leur isolement, leurs difficultés matérielles et les conséquences négatives sur les enfants. En France comme aux Etats-Unis, la monoparentalité est un facteur de grande précarité.
Dans l’inconscient collectif, dans les médias et pour de nombreux experts, les mères seules « par choix » ne peuvent donc qu’être égoïstes, indifférentes au bien-être et à l’équilibre de leur enfant, qu’elles privent volontairement de père et qu’elles promettent en plus à un avenir incertain.
Susan Golombok commence par souligner que les mères seules par choix sont le plus souvent éduquées, insérées socialement, financièrement à l’aise, plus âgées que la moyenne des femmes au premier enfant. Elles n’ont pas pris leur décision sur un coup de tête, y ont mûrement réfléchi, ont consulté leur famille et leurs amis, se sont assurées qu’elles avaient les moyens matériels d’élever un enfant et qu’elles avaient dans leur entourage des proches susceptibles d’offrir un modèle masculin. Ces femmes n’ont donc pas grand chose à voir avec le profil des mères se retrouvant seules sans l’avoir voulu et ayant du mal à joindre les deux bouts.
Les études qui montrent un lien entre la monoparentalité et les difficultés, notamment scolaires, des enfants, mettent surtout en exergue les difficultés économiques des mamans solo et leur fragilité psychique après la séparation. C’est la dimension économique et sociale et la dépression maternelle qui semblent avoir un impact sur les enfants, plus que le fait qu’ils vivent avec un seul parent. D’autres études montrent aussi que ce sont les mauvaises relations entre les deux parents plus que la séparation en elle-même qui semble délétère pour les enfants. A priori, ces facteurs de risque ne concernent pas les mères seules par choix.
Deux études ont été menées pour analyser les capacités maternelles de ces femmes et le développement de leurs enfants (petits, entre 6 mois et 7 ans). Les résultats montrent de bonnes relations mère-enfant, un investissement maternel meilleur que chez les femmes en couple hétérosexuel et une perception de l’enfant plus positive. Les enfants, eux, se développent correctement, sans problème particulier. Mais ils sont jeunes et c’est au moment de l’adolescence que sonnera l’heure de vérité. Comment réagiront-ils s’ils ne peuvent pas accéder à l’identité de leur géniteur (souvent un donneur anonyme). Les rares études sur les adultes issus d’un don montrent que ceux qui ont grandi uniquement avec leur mère sont plus susceptibles de rechercher leur donneur (même s’ils le font par curiosité plus que pour trouver un père).
Les couples gay, meilleurs parents adoptifs que les autres
Donc, il n’est pas forcément besoin d’un père pour faire famille, semble dire Susan Golombok avec les mamans solo. Pas de jaloux, le contraire serait tout aussi vrai : une mère, pourquoi faire ? Au-delà de cette formulation volontairement provocatrice, notons que l’intérêt, entre autres, des études sur l’homoparentalité, c’est qu’elles amènent à réinterroger la répartition sexuée des rôles parentaux en général, sujet qui là encore, n’a eu de cesse de faire débat en France. Qu’est-ce qu’un père, qu’est-ce qu’une mère, de qui l’enfant a-t-il le plus besoin et à quel âge ?
Susan Golombok se soucie peu des théories et des guerres idéologiques. Ce qui l’intéresse, ce sont les études. Et que disent-elles sur le sujet ? Dans les couples hétérosexuels, les pères influencent leurs enfants de la même faon que les mères. Les aspects de la parentalité qui comptent le plus pour le bien-être des enfants, tels que la chaleur, la capacité à répondre aux besoin, et la sensibilité sont les mêmes quel que soit le sexe du parent. C’est la qualité de la relation du père à son enfant qui compte, davantage que son genre. « L’influence de la paternité sur l’enfant est équivalente et même interchangeable avec celle de la mère, écrit-elle. La plupart des habiletés parentales s’apprennent sur le tas et lorsque les hommes passent un peu plus de temps à faire le boulot, ils deviennent aussi bons que les mères. »
La plupart des études (encore récentes) effectuées sur les couples gay concernent des pères ayant adopté. Les données ne permettent pas d’avoir du recul (les enfants suivis étaient encore petits). Ce qui a d’ores et déjà pu être mis en exergue : les parents gay prodiguent un environnement familial secure et leurs enfants semblent épanouis. Une étude anglaise a notamment abouti à des conclusions assez édifiantes. Contrairement à la France, l’adoption est essentiellement nationale en Grande-Bretagne. La plupart des enfants adoptés sont des pupilles de l’Etat et proviennent des services sociaux. Ils ont donc souvent, même lorsqu’ils sont petits, un passé difficile, et des antécédents d’abus psychiques, physiques ou sexuels. Les couples de pères qui adoptent ces enfants s’en sortent apparemment beaucoup mieux que les couples hétérosexuels. Ils sont plus chaleureux, interagissent plus positivement, manifestent moins d’agressivité pour poser leur autorité. Du côté des enfants, les problèmes de conduite sont moins importants dans les familles adoptives gays et lesbiennes que dans les familles hétérosexuelles. Ce qui donne effectivement à réfléchir et bat en brèche l’argument selon lequel ce serait ajouter un fardeau supplémentaire à un enfant que de lui imposer une famille hors norme après la blessure de l’abandon.
En conclusion: le fonctionnement d’une famille compte bien plus que sa composition
Voici un un condensé de la dizaine de pages qui viennent conclure le livre de Susan Golombok.
« Bien que les enfants dans les familles formées par des lesbiennes, des gays, des mères seules (par choix) ou par le recours à l’AMP sont indistinguables des enfants des familles traditionnelles en terme de bien-être psychologiques, il existe des différences de qualité de la parentalité entre ces familles, pose l’auteure. Contrairement aux attentes, ces différences reflètent généralement un niveau de qualité plus élevé plutôt que plus faible chez les nouvelles familles. L’explication la plus plausible pour ces résultats inattendus résident dans la très forte motivation dont ces personnes ont dû faire preuve pour avoir leurs enfants ».
Susan Golombok le martèle : « toutes ces études arrivent à la même conclusion : le fonctionnement familial, la qualité des relations entre les parents et les enfants et entre les parents eux-mêmes, aussi bien que l’attitude de la société vis-à-vis de la famille, sont plus prédictifs de l’ajustement psychologique des enfants que la structure de la famille elle-même. » Plus loin elle écrit : « c’est la stigmatisation en dehors de la famille, plus que les relations en son sein, qui sont sources de difficultés pour les enfants qui grandissent dans ces nouvelles structures familiales ».
Voici sa dernière phrase : « Quarante années de recherche sur ces familles ont échoué à conforter l’assertion que la famille traditionnelle est nécessairement le meilleur environnement dans lequel élever un enfant. Des familles de toute forme et toute taille se développent. Que les enfants aient un parent ou deux, que leurs parents soient des hommes ou des femmes, que ces derniers soient du même sexe ou du sexe opposé, qu’ils aient un lien gestationnel ou génétique avec eux, et qu’ils aient été conçus naturellement ou via une technique de reproduction assistée, tout cela semble moins compter pour des enfants que la qualité des relations familiales, le soutien de leur communauté et les attitudes de la société dans laquelle ils vivent.»

